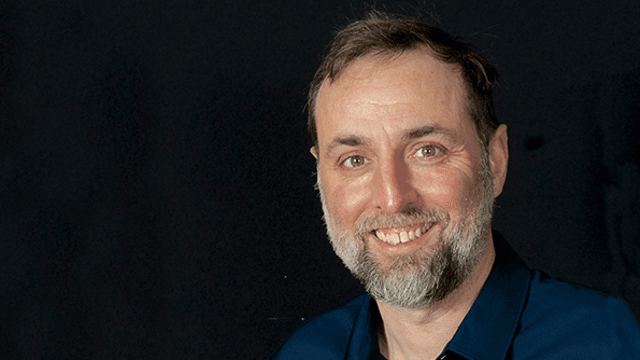Arnold Fauquette (BBA 1997) : l’entrepreneuriat à impact pour répondre à la perte d’autonomie
Arnold Fauquette (EDHEC International BBA 1997) est fondateur et directeur de Vivat, groupe de services d’aide à domicile qui intervient sur le département du Nord et emploie près de 200 auxiliaires de vie. Il met à égalité le bien-être des salariés et des personnes accompagnées face au vieillissement. Vivre chez soi quand on est en perte d’autonomie est pour Arnold une réalité, qu’il nous partage dans cet entretien, avec quelques solutions pour les générations futures.
Comment perçois-tu la perte d’autonomie des personnes âgées ?
En travaillant auprès de personnes âgées fragiles, je me suis vite rendu compte qu’on a paradoxalement tendance à surprotéger et à cloisonner. Pendant la période COVID, certains établissements ont été fermés aux visiteurs extérieurs, et aujourd’hui encore des mesures empêchent certaines personnes âgées de recevoir de la visite. Aujourd’hui se multiplient les offres de restauration où on coupe le fromage à la place des résidents. Ils sont dépossédés de ce qu’ils peuvent encore faire ! Chacun, quel que soit son âge ou sa situation, doit être accompagné pour être le plus possible maître de son destin et de ses choix professionnels. J’ai l’impression que cette attente a été renforcée par le COVID ; on s’est réinterrogé sur la notion de sens du travail. On ne doit pas priver de cette approche une tranche de la population moins sollicitée. Comme elle est plus âgée, on va prétendre savoir – à tort – ce qui est bon pour elle.
Cette approche autonome se retrouve dans l’environnement de travail de Vivat, notamment via la méthode Montessori utilisée lors de vos ateliers, ou encore le recrutement par les collaborateurs eux-mêmes…
On essaie d’aller chercher une forme d’enthousiasme. Dans le secteur de l’aide à domicile, on est confronté à la dépendance, au grand âge, parfois à des situations de famille un peu lourdes. C’est un métier compliqué, qui est fait dans une sphère privée parfois oppressante, avec des amplitudes de travail parfois difficiles Le rapport entre la santé et le travail est très visible parce qu’une salariée en bonne santé, épanouie, a un impact ultra-positif sur les personnes qu’elle accompagne. Ça vaut tous les médicaments. On essaye donc de créer les meilleures conditions de travail pour des centaines d’auxiliaires de vie : équilibre entre travail et sphère privée, pouvoir s’organiser par exemple avec les collègues pour aller chercher ses enfants à 17h…
N’est-ce pas aussi une façon d’aligner les valeurs de l’entreprise avec le fonctionnement interne ?
Sur l’alignement, j’aurais tendance à dire que la première étape est d’être une entreprise alignée par rapport aux convictions du dirigeant. Je suis la même personne dans ma vie personnelle et dans ma boîte. Je vise une posture d’authenticité, en disant qu’il y a des choses sur lesquelles je peux agir – le cadre de travail, ou donner envie à des professionnels de faire ces métiers –, mais je ne peux pas garantir que la sphère privée ne reprendra jamais le dessus et mette les collaborateurs en difficulté. C’est à moi d’expliquer aux clients qu’on ne trouve pas forcément une auxiliaire de vie aussi facilement qu’il y a 30 ans. Ma mission est aussi de dire que pour que chacun puisse rester chez soi le plus longtemps possible, il faut aussi une certaine forme d’éveil sociétal, dire qu’on y arrivera tous ensemble.
Depuis tes débuts d’entrepreneur, as-tu vu une évolution de la notion d’impact sociétal ?
Quand je suis sorti de l’EDHEC Business School, je voulais faire ce que j’avais appris : organiser, aller à la conquête de marchés, développer, innover et créer. Je suis assez attaché à la notion de liberté, c’est pourquoi j’ai pris l’initiative d’entreprendre. Quand j’ai commencé à embarquer du monde dans une conception pyramidale, j’ai découvert que je générais pas mal de souffrance. J’avais des collaborateurs en difficulté, je n’arrivais pas à dépasser une certaine qualité de service vis-à-vis des familles. Je me suis demandé s’il existait d’autres manières de travailler ou si je n’étais simplement plus la bonne personne. Et je me suis rendu compte que je devais être avec les autres plutôt qu’au-dessus d’eux, et en première ligne. J’ai donc réorganisé l’organisation en 2015 vers le concept d’entreprise libérée. Pour être heureux et trouver sa place professionnellement, un collaborateur doit peut-être aussi se sentir en confiance et avoir un certain niveau d’autonomie dans son organisation de travail, ses prises de décision, pouvoir aller explorer certains sujets qui l’intéressent. Je suis aujourd’hui assez éloigné du dirigeant que je rêvais d’être quand je suis sorti de l’école. En revanche, je pense être plus fidèle au jeune que j’étais. Avec le Mouvement Impact France, des dirigeants ont l’intention de rendre visible la notion d’impact au niveau national, et de vraiment travailler sur cette prise de conscience.
Au sujet de l’entrepreneuriat, l’ambition suffit-elle aujourd’hui ou un certain devoir de citoyenneté lié à cet entrepreneuriat est-il également de mise ?
Comme chaque terme de vocabulaire qui « englobe », il peut y avoir un effet de mode, et une utilisation du terme par des gens qui n’en font pas. En tant que Vice-Président du Réseau Entreprendre Nord, j’ai le sentiment que la grande majorité des porteurs de projets en TPE-PME intègrent une réflexion sur l’impact de leur structure. Il y a le regard cohérent qu’au-delà de servir la communauté, on est attentif à proposer des emplois de qualité. On ne peut pas se contenter de construire des boîtes aujourd’hui en ne regardant que la dernière ligne du bilan. Mais même si les prises de conscience existent chez les acteurs économiques, l’environnement n’y prête pas toujours attention. Il y aussi un problème de jargon, la tech d’un côté, et les assos en RSE de l’autre, et personne ne se comprend. Il me semble important dans les environnements scolaires, y compris en école de commerce, qu’on ouvre les rêves des entrepreneurs : ça ne doit pas se résumer à la création de start-up. Il y a beaucoup d’appelés pour très peu d’élus, c’est un monde très agressif. J’ai vraiment cette envie qu’on puisse davantage aussi se projeter sur de nouveaux modèles entrepreneuriaux peut-être plus frugaux, avec un niveau de conscience un petit peu plus élevé, mais qui peuvent être je pense tout autant source de bonheur, de plaisir, de simplicité. Il faudrait aussi monter les niveaux d’exigence des appels d’offres car seules 5% des entreprises sont du domaine de l’économie sociale et solidaire. Les dirigeants sont complètements prêts, ils ne veulent plus se bagarrer uniquement sur les prix, mais sur les valeurs, la qualité et le niveau de service. Il faut juste que le monde politique suive.
Toutes les personnes en perte d’autonomie pourront-elles être prises en charge d’ici à 2050, où la population de plus de 75 ans aura doublé ?
J’ai envie de dire qu’on pourra les prendre en charge, mais uniquement avec des solutions qui ne s’appuieront pas sur les moyens d’aujourd’hui. J’ai du mal à imaginer que notre société s’adapte aux enjeux du vieillissement si les professions périphériques au contact avec les personnes fragiles ne sont pas justement considérées. On peut vivre en milieu ordinaire très longtemps, avec le développement d’équipes mobiles de santé, dans des petites structures, dans des projets d’habitat partagé et inclusif. On n’a pas forcément besoin d’aller dans un établissement spécialisé, d’être isolé de sa famille. Les enjeux vont être de permettre aux familles confrontées à la dépendance de leurs proches de pouvoir participer, sur leur territoire, en lien avec les communes, avec des organismes régulateurs aussi, à la mise en place de l’accompagnement dans de petites unités. Mon sentiment est que les recours ne vont pas uniquement venir des professionnels, mais d’une société plus inclusive. Un commerçant devrait savoir repérer quand des clients réguliers ne viennent pas, un voisin devrait pouvoir savoir quand s’inquiéter. Une communauté de quartier peut se former aux pathologies, connaître les résidents qui en sont atteints, et donc venir soulager des familles à distance, ne serait-ce qu’en allant chercher le pain. Les innovations digitales pourraient favoriser ces interconnexions. Ce que veulent les aidants familiaux, ce ne sont pas des congés supplémentaires et des indemnités, mais pouvoir souffler, partager leurs difficultés, être soulagés.
Quel est alors le rôle de l’État ?
Il faut un régulateur. Quand on entre en maison de retraite, on constat souvent le grand dévouement des soignants. L’échelon qui bloque, c’est au-dessus, d’où la nécessité d’organisations plus petites. Il ne faut pas que les soignants et directeurs d’établissement soient impactés par des injonctions qui viennent de trop loin. Dans un lieu commun respectueux, les soignants ont des bonnes conditions de travail, les familles sont bien accompagnées et on donne la parole aux personnes accompagnées non pas à travers une enquête satisfaction avec trois croix pour noter la qualité du secrétariat. En ayant nettoyé les injonctions contradictoires, entre rentabilité et bien s’occuper des gens, cet équilibre va se faire tout près des gens qui gèrent une structure, ils sauront quand ils pourront faire une économie ou non. Je crois à ce modèle plus organique, plus ancré sur les territoires mais aussi qui irait chercher plus d’implication citoyenne. Sur le campus de l’EDHEC par exemple, on pourrait songer à des contenus de participation à la citoyenneté, pour s’engager et revendiquer ce qui est important dans la proximité du territoire. Quand on va chercher un peu de bon sens autour de soi, ça marche !
Est-ce la fin du système des EHPAD ?
Je ne pense pas que ce soit complètement la fin des EHPAD. C’est la fin d’un système et des organisations déshumanisées qui ne mettent pas la dignité au cœur de leur modèle. L’EHPAD est le dernier moment de vie, donc on devrait avoir le droit de s’y amuser un peu. Ceux qui sont en EHPAD aujourd’hui ne s’attendaient pas du tout à vivre aussi longtemps. Cette génération a fait la guerre, a vécu après les phases de progrès, mais a perdu ses parents très jeunes. Elle a énormément travaillé et connu des emplois très pénibles. Elle ne s’est pas vue vieillir, et elle subit un peu, parce qu’elle n’est pas familière des manifs et des revendications au droit à l’autonomie. Mais on peut tout à fait imaginer des lieux collectifs où la dignité soit vraiment le cœur de l’accompagnement. L’Homme est fait pour vivre avec des compatriotes dans un lieu agréable, où on fait attention à ses loisirs, où on s’occupe bien de lui.
Au-delà du lien de proximité et entre les générations, quels autres enjeux existe-t-il ?
L’humanisation de l’accompagnement au vieillissement nécessite des innovations numériques pour accompagner les professionnels. Les auxiliaires de vie pourraient par exemple être au premier niveau de télémédecine. Il y a aussi la dimension technique : adapter les domiciles avec des capteurs pour assurer le maintien à domicile de personnes qui perdent leur niveau d’autonomie, ou développer des projets d’exosquelettes pour faciliter les déplacements des personnes accompagnées. La personne doit se sentir en sécurité chez elle, sans être cernée de caméras ! La vie sociale, les divertissements et les voyages de demain sont un autre axe. La Silver Economy a beaucoup d’avenir mais il manque un lien entre les employeurs et les acteurs de la tech. On pourrait collaborer avec les opérateurs de téléphonie mobile sur autre chose que le développement de téléphones avec des grosses touches. Cela nécessitera un échange d’informations plus rapide et direct.

Commentaires0
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés