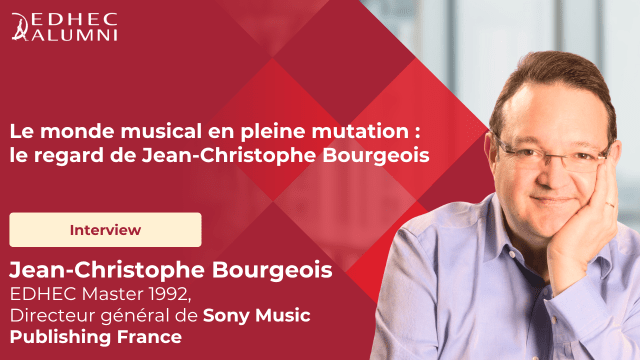Interview avec Jean-Christophe Bourgeois (EDHEC Master 1992), Directeur général de Sony Music Publishing France
À chaque fois qu’une œuvre musicale du catalogue de Sony Music Publishing est jouée, enregistrée ou reproduite, des droits sont versés à ses auteurs-compositeurs, comme pour tout autre éditeur musical. Jean-Christophe Bourgeois (Master 1992 et Affiliate Professor à l'EDHEC), Directeur général de la filiale française, explique comment la bascule du monde musical au début des années 2000, puis pendant la période COVID, a redéfini le rapport aux artistes, à leur rémunération et à leur développement de carrière.
Comment résumerais-tu ton poste et tes responsabilités actuelles ?
Je supervise l’exploitation de notre catalogue et je contribue à développer notre vivier d’artistes. J’ai aussi une partie financière qui peut être transverse, et je travaille sur les acquisitions de catalogues. La dimension institutionnelle, que je développe depuis une dizaine d’années, m’a de plus amené à siéger actuellement au conseil d’administration de la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (Sacem) – d’où provient la grande majorité du chiffre d’affaires des éditeurs français, car elle est l’intermédiaire pour les droits lorsque les musiques sont jouées à la radio, en concert, en club, en streaming, ou reproduites sur CD –, Vice-président de la Chambre Syndicale de l’Édition musicale, et Président de Tous Pour La Musique, une association d’une trentaine d’organisations représentatives de la filière (syndicats de salariés, producteurs de spectacles, représentants de plateformes, attachés de presse, orchestres, opéras…).
Qu’est-ce qui t’anime dans le travail avec les artistes ?
Ce travail change complètement d’un artiste à l’autre. Certains de nos auteurs-compositeurs sont artistes-interprètes de leurs propres œuvres, alors que d’autres écrivent uniquement pour des interprètes tiers, comme nos beatmakers, qui font des productions et des tracks pour de nombreux rappeurs, sans être eux-mêmes interprètes. Quel que soit leur profil, il faut les accompagner dans leur carrière, les aider à atteindre le succès et leurs objectifs créatifs, parler d’une seule voix avec eux. Notre apport varie selon la période de leur carrière et leurs ambitions artistiques, mais il peut et doit être essentiel, car vivre de sa musique n’est pas simple. 120 000 nouveaux titres sont uploadés chaque jour sur les plateformes, ce qui donne une idée de la concurrence et de la difficulté à se faire entendre et à aller à la rencontre du public. Dans ce contexte, j’aime tout particulièrement le travail de l’éditeur, car il intervient souvent au début de la création des œuvres, de leur production, du développement du répertoire d’un artiste et de sa communauté, et doit commencer à raconter une histoire pour ensuite fédérer et agréger d’autres partenaires, tels que les producteurs phonographiques ou les producteurs de spectacles. J’apprécie également que la relation d’un éditeur avec des créateurs puisse se poursuivre pendant de longues années. J’ai ainsi signé le groupe KYO quand ils avaient 16 ans, et nous venons de fêter les 20 ans de leur album Le Chemin, que nous avons réenregistré, et autour duquel nous avons construit une tournée de célébration conclue par une date complète à l’Accor Arena, avant de partir sur un nouvel album. Chaque histoire est différente, chaque créateur doit être accompagné de manière spécifique et évolutive avec le temps : c’est cela qui est passionnant.
La façon de repérer des artistes a-t-elle changé ?
Non, c’est surtout que le secteur se renouvelle sans cesse. Tout a été battu en brèche par des révolutions successives : le MP3, le partage de fichiers en pair-à-pair, l’écroulement du marché du CD, puis l’avènement du streaming, qui a rebattu les cartes et oblige les artistes à sortir de la musique différemment, voire à en sortir plus. Les réseaux sociaux sont bien sûr devenus un vecteur essentiel de repérage et de promotion. Il y a 10-15 ans, c’était beaucoup du réseau, de recommandations, de premières parties de concerts. Il y a une tendance assez forte ces dernières années à mettre la data – followers et vues sur TikTok, Instagram et les plateformes, notamment – au centre des choix d’artistes signés. La data est une source d’information essentielle, mais elle ne permet pas toujours de faire de bons choix : certains artistes avec de la data très significative à un moment donné ne sont pas forcément pérennes, alors qu’un éditeur cherche à construire des carrières et des actifs qui vont avoir une valeur résiduelle forte. Par ailleurs, quand la data vient valider un début de succès, tout le monde a déjà les yeux rivés sur ces artistes, et les conditions de signature se durcissent. Le but est donc d’arriver le plus tôt possible, et parfois aussi de signer des artistes avant qu’ils n’aient des chiffres significatifs sur les réseaux sociaux.
Quelle place ont les artistes dans ce nouvel environnement ?
Le marché est tel que les maisons de disques préfèrent souvent accompagner des artistes qui ont déjà une vision plutôt que de créer « à partir de zéro ». Une priorité est donnée à ceux qui sont autonomes, qui savent développer et engager une communauté, construire leur image. J’ai encore la chance de pouvoir faire des paris, mais je dois parvenir, en collaboration étroite avec l’artiste, à construire un storytelling suffisamment puissant pour que d’autres partenaires se joignent à nous dans l’aventure. Être artiste aujourd’hui est donc particulièrement difficile, pour toutes les casquettes qu’il est demandé d’avoir en même temps – c’est d’ailleurs pour cela qu’on parle de plus en plus d’ « artiste-entrepreneur ». Il faut avoir la capacité de persévérer et de trouver sa voix sur les réseaux, de créer du contenu qui enthousiasme les gens, de comprendre comment les algorithmes fonctionnent, de faire grandir sa communauté. Je trouve que les artistes réussissent, malgré toutes ces injonctions, à produire de la musique de grande qualité, mais au prix de très grands efforts, qui peuvent avoir un effet négatif sur leur quotidien, et posent parfois même des questions de santé mentale.
En quoi la France constitue-t-elle un marché à part ?
Le secteur privé y est actif et vigoureux, ce qui contribue à la forte part de marché des artistes locaux, une spécificité de notre territoire. La France est par exemple le premier marché après les États-Unis sur le rap, entièrement grâce à notre production locale. Et nous avons la chance d’avoir une culture subventionnée – un modèle parfois mis à mal par les choix budgétaires actuels –, avec une vraie ambition de service public qui permet notamment de maintenir un haut niveau d’opéra et d’orchestres, et de contribuer à une diversité d’esthétiques, que beaucoup de pays nous envient. Un des effets positifs de cette dynamique, c’est que notre musique s ‘exporte : de la French Touch au jazz en passant par l’Afro pop, notre répertoire voyage. J’ai ainsi la chance de travailler avec des artistes « électro » dont la musique traverse les frontières, comme Gesaffelstein qui a composé 4 titres du dernier album de Lady Gaga, Petit Biscuit dont le titre « Sunset Lover » approche le milliard de streams sur Spotify, ou M83 dont la musique fait référence outre-Atlantique. Mais aussi Gims ou Zaz, dont le succès global montre que le français n’est plus un frein à l’international. Nous nous battons constamment pour montrer l’attractivité du marché français et sa qualité créative.
Comment a évolué la répartition des droits d’auteur, entre les différents supports ?
Les années post-COVID ont connu un boom du live, par une combinaison de 2 facteurs. D’abord, l’appétit de partager la musique, qui rassemble des publics et des cultures très différents, a été très fort en France. Par ailleurs, de nombreux artistes qui avaient été empêchés de tourner pendant le COVID sont repartis sur les routes dès que cela a été possible. D’autant plus que, pour nombre d’entre eux, la croissance du streaming n’a pas encore compensé les revenus déclinants issus de la vente de CD. Car même si le marché de la musique enregistrée est en croissance depuis plusieurs années, il avait chuté de manière tellement brutale au début des années 2000 qu’il est loin d’avoir retrouvé ses plus hauts niveaux.
Outre l’explosion du live et le développement du streaming, les auteurs-compositeurs et les éditeurs ont aussi bénéficié de la croissance du marché de la synchronisation (droits forfaitaires payés pour pouvoir utiliser une œuvre dans un programme audiovisuel, un film, une campagne publicitaire, un jeu vidéo…), qui est devenue une ressource importante – à hauteur d’environ 20% des revenus en moyenne, le pourcentage pouvant être bien plus élevé pour la musique purement instrumentale ou électronique.
Qu’est-ce qui te motive à siéger au conseil d’administration de la Sacem ?
Dans mes aventures institutionnelles, je souhaite rendre ce qu’on m’a apporté. Je voulais travailler dans le monde de la musique depuis tout petit, et j’ai la chance de pouvoir le faire, aux côtés de personnes extrêmement investies, talentueuses et passionnées. Il y a donc d’abord un sens de l’intérêt collectif et du bien commun. Concernant le CA de la Sacem en particulier, je me suis dit que c’était le moment de me présenter, car les enjeux sont importants, plus que jamais. Pour ma première année au conseil, je voulais donc contribuer à mon échelle, avec la volonté de servir cette communauté d’auteurs-compositeurs et d’éditeurs qui m’ont élu. Il y a d’ailleurs une attente de plus en plus forte des sociétaires : au-delà de la représentation, nous devons prendre des décisions et les guider dans un environnement plus complexe et anxiogène qu’il y a vingt ans. J’ai par exemple travaillé avec les autres administrateurs et les services de la Sacem sur un papier définissant une position claire et concrète au regard de l’intelligence artificielle, vis-à-vis des 240 000 sociétaires.
Comment la Sacem concilie-t-elle les révolutions technologiques avec la protection des artistes ?
La protection des sociétaires et des œuvres est une mission-clé de la Sacem. Et plus largement, à plus long terme, la défense des métiers d’auteur/autrice, compositeur/compositrice, éditeur/éditrice, doubleur sous-titreur/doubleuse sous-titreuse, réalisateur/réalisatrice. Les projections à 5 ans sont difficiles, en raison de l’évolution rapide des outils et de leur capacité. Nous essayons donc de penser à demain et à après-demain, en nous donnant la possibilité de toujours ajuster nos positions, comme celle sur l’IA. Par défaut, demander aux auteurs l’autorisation d’utiliser leurs œuvres, et ne pas déposer d’œuvres créées uniquement avec l’IA, est une position forte et claire de la Sacem. Nous essayons de dessiner un avenir avec des parlementaires, des politiciens, des chefs d’entreprise, en montrant que le progrès économique n’est absolument pas antinomique de la protection du droit d’auteur, qu’il est possible de conclure des accords de licence dans des projets d’IA respectueux de l’humain. Plutôt que de dénigrer les avancées technologiques, il faut les embrasser et s’assurer qu’elles préservent les créateurs, dans un contexte de transparence et de traçabilité.

Commentaires1
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés